|
JEAN
GASCOU
 Jean
Gascou est professeur de langue grecque et papyrologie
à l’Université des Sciences Humaines
de Strasbourg. Il y dirige l’Institut de Papyrologie
associé à l’UMR 7572 du CNRS et enseigne
cette discipline rare aux méthodes de pointe. Jean
Gascou est professeur de langue grecque et papyrologie
à l’Université des Sciences Humaines
de Strasbourg. Il y dirige l’Institut de Papyrologie
associé à l’UMR 7572 du CNRS et enseigne
cette discipline rare aux méthodes de pointe.
Comment
êtes-vous venu à la papyrologie ?
Je suis historien de formation. Je m’intéressais et je m’intéresse
toujours à l’histoire byzantine, au Bas-Empire. Pendant
mes études, j’ai eu connaissance, tout à fait par hasard,
d’un enseignement de papyrologie byzantine très tourné
vers l’histoire. Il était dispensé à l’EPHE IV par Roger
Rémondon, dont j’ai fréquenté les cours pendant trois
ans. Parallèlement, j’ai suivi à la Sorbonne l’enseignement
de Jean Scherer, consacré à la papyrologie dans
son ensemble et dans une vue plus technique que Rémondon.
Comment
devenir papyrologue ?
Eh bien, il faut savoir le grec. On devient papyrologue soit en
étant un historien ayant fait un peu de grec, et c’était
mon cas, soit comme helléniste à l’exemple de la plupart
des papyrologues si bien que je ne sais si je peux recommander
ma propre voie.
Quoi
qu’il en soit, on ne peut pas faire l’impasse sur la langue.
Ce n’est pas trop difficile, il ne faut pas en avoir peur.
Le grec des papyrus n’est pas celui de Platon ni de
Démosthène. C’est une langue évoluée, simplifiée.
Tant mieux bien sûr si l’on est en même temps démotisant
ou coptisant, voire sémitisant. Il faut en outre aimer
et connaître les sciences de l’Antiquité, en particulier
cette discipline sœur de la papyrologie qu’est l’épigraphie.
Quant aux enseignements, il y a actuellement en France
deux instituts de papyrologie actifs : à Paris IV,
sous la direction d’Alain Blanchard, et à Strasbourg,
sous ma responsabilité. Certains collègues, historiens
ou hellénistes, assurent des séminaires dans des établissements
parisiens comme l’EPHE (ainsi Joseph Mélèze)
ou dans des universités de province, comme Lyon (Marie
Drew-Bear). Mais les centres de Strasbourg et de Paris
sont les mieux équipés. Ces deux instituts ont des bibliothèques
et autres équipements tout à fait complets.
Que
peut apporter la papyrologie aux autres sciences ?
C’est une discipline philologico-historique, où la discussion
du document est très serrée. Nous nous confrontons
continuellement à des problèmes de « pathologie » éditoriale,
ou aux théories des savants antérieurs dans l’état où,
si l’on peut dire, elles ont été abandonnées. En éliminant
les erreurs, nous capitalisons aussi les acquis de la
discipline. La papyrologie progresse d’une génération
sur l’autre, comme une science exacte. C’est très satisfaisant
intellectuellement, et c’est cette méthode très critique
ou même négative qui peut avoir de l’intérêt pour les
spécialistes de l’Antiquité.
L’informatique
est très utilisée dans cette science.
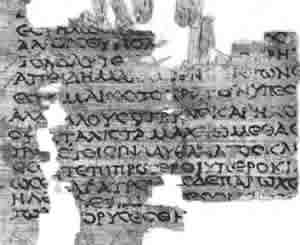
Fragment d’Homère
sur papyrus
(Musée Royaux d’Art et d’Histoire,
Bruxelles) |
Oui,
c’est un trait de la papyrologie. Depuis dix ou quinze
ans, ce mouvement d’informatisation, parti des Etats-Unis,
et largement soutenu par le mécénat privé, a transfiguré
notre discipline. Il est vrai que la papyrologie disposait
de longue date d’excellents instruments de travail, si
bien que l’informatisation n’est que le développement
inévitable d’une excellente organisation antérieure, car
soit dit en passant, la papyrologie est une discipline
très structurée, très intégrée. Le milieu papyrologique
forme une sorte de « république des lettres ».
Personne n’y est insularisé.
Nous
avions donc déjà, depuis le début du siècle, des dictionnaires,
des périodiques et des recueils très particuliers. Ainsi
toutes les corrections dont les textes font l’objet au
cours des années sont compilées dans un périodique comptant
actuellement 9 (et bientôt 10) volumes. Les textes publiés
isolément sont rassemblés et indexés dans des recueils
(20 volumes à ce jour pour plus de 15000 textes). Notre
bibliographie annuelle, rédigée depuis des décennies à
Bruxelles sur des fiches cartonnées, s’est tout
naturellement transposée sur un support informatique à
compter de 1995. Mes collègues de Bruxelles en proposent
maintenant une version électronique expérimentale qui
couvre les années 1960 à 1998. L’informatisation des données
documentaires, sous forme de banques numériques textuelles
ou de banques d’images, nous a amenés à travailler d’une
manière radicalement différente des usages antérieurs,
de même qu’elle nous a ouvert de nouveaux champs scientifiques,
notamment dans l’histoire de la langue grecque, mais elle
n’a pas entraîné de rupture avec l’esprit de la discipline.
A Strasbourg même, nous numérisons les papyrus pour faciliter
leur déchiffrement et pour préparer leur publication.
Nous gravons des cédéroms pour diminuer la taille de la
documentation photographique traditionnelle. Nous utilisons
les logiciels de traitement des images en usage en PAO
et chez les graphistes. Je dois dire que c’est une technique
très convaincante qui nous a donné d’excellents résultats.
Nous avons certainement opéré une avancée dans ce domaine.
A l’étranger, un certain nombre d’instituts, comme Heidelberg,
ont atteint ce niveau. Mais en France, je crois bien que
nous avons été les premiers à appliquer le traitement
de l’image à la recherche papyrologique fondamentale.
Pour autant,
reste t-il important de travailler sur le terrain ?
Le
terrain apporte la connaissance géographique du pays et
des sites, qui importe, vous le réalisez, à la mise
en perspective des documents. Un papyrus dont on ne
connaît pas la provenance ou même tout simplement l’environnement
concret est un document à peu près mort. Voilà déjà ce
qui recommande le terrain.
La
seconde raison est qu’en Egypte, il y a l’IFAO.
C’est un lieu où les gens se rencontrent et échangent
leurs expériences. L’IFAO est aussi une institution d’avant-garde,
bien équipée et où l’on développe de nouvelles techniques.
Puis il y a bien sûr les fouilles de l’IFAO qui nous livrent
des documents en contexte. Prenez ainsi les investigations
d’Hélène Cuvigny dans le désert oriental avec ces
milliers d’ostraca qu’elle y a découverts. Pour diverses
raisons, le contexte archéologique des trouvailles d’ostraca
échappe trop souvent aux papyrologues. Il est d’autant
plus précieux d’en avoir à présent en grand nombre et
correctement relevés. La connaissance du contexte donne
à ces documents souvent répétitifs et de contenu très
pauvre un relief très vif.
Quels
sont les débouchés pour les jeunes diplômés ?
Dans
le long terme, soit l’enseignement du grec, soit de l’histoire
ancienne. A moyen terme, un séjour à l’IFAO peut intéresser
un jeune savant. Nous manquons de papyrologues
: l’IFAO n’en a pas à demeure chaque année. Après l’IFAO,
un passage par le CNRS est presque nécessaire puisque
les postes offerts par l’Université, sans être aussi rares
qu’on le croit, sont profilés d’une manière qui empêche
quelquefois le recrutement de spécialistes un peu pointus.
J’estime que le CNRS est une institution accessible, qui
s’ouvrira toujours à tout chercheur original et pourvu
d’un bon dossier.
Pourtant, je ne conseillerais pas aux jeunes de rester trop longtemps
au CNRS. Je voudrais qu’ils se rendent compte que passer
toute sa vie dans les bibliothèques, cela marginalise,
cela aigrit même. Je suis très content d’être enseignant.
Je sais bien que ce métier a de graves inconvénients,
qu’il fait peser en particulier sur les professeurs une
insupportable charge bureaucratique et gestionnaire, mais
le contact avec les étudiants, les doctorants, les chercheurs,
est très précieux. Ce sont eux qui me donnent des idées.
C’est un doctorant égyptologue, Guillaume Bouvier,
qui m’a aidé à moderniser mon institut. On profite de
tout cela. Il ne faut pas croire qu’on devient nécessairement
le plus fort quand on se confine trente ans au CNRS. Encore
une fois, la marginalisation y est presque fatale. Voilà
du moins la leçon que je tire de vingt-cinq ou trente
ans de papyrologie, dont 9 passées au CNRS et 10 à l’université.
Comment
s’organise la coopération internationale ?
Nous
tenons un congrès tous les trois ans, qui se tient cette
année à Florence. Nous avons aussi des instances régulatrices
de notre activité, avec une association internationale
et un comité international patronnant la mise à jour de
nos instruments de travail. Nous disposons également des
ressources de la « toile » comme on dit. S’est constitué
en particulier un groupe de discussion papyrologique
basé à Copenhague, auquel la plupart des papyrologues
sont affiliés, et qui permet d’échanger des points de
vue, des informations, par exemple sur les dernières publications,
qui sont ainsi connues en un temps record. Spontanément,
nous diffusons tout ce que nous pouvons savoir.
Quelles
sont vos recherches actuelles et vos projets ?
Il s’agit principalement d’un projet collectif, l’édition des papyrus
byzantins de Lycopolis, qui appartiennent à l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, et que Jean-Luc
Fournet a restaurés l’an dernier à Paris. Nous les
avons saisis au siège de notre laboratoire CNRS, au Collège
de France. Nous avons transporté les images à Strasbourg,
et nous les avons sauvegardées sur des cédéroms.
J’ai d’autres projets, comme la poursuite de l’édition et la numérisation
des papyrus de la collection de la BNU de Strasbourg,
qui est très riche. Elle remonte au régime allemand, à
une époque où l’on estimait en Allemagne que la papyrologie
était obligatoire pour tous ceux qui étudiaient le grec.
Plus personnelles sont mes recherches sur des trouvailles textuelles
importantes qui ont été faites en Syrie, il y a dix ans.
Avec un collègue spécialiste de la Syrie, D. Feissel,
j’édite la partie grecque du dossier. C’est une deuxième
spécialité, si vous voulez.
Entretien réalisé au Caire en mars 1998 par Renaud de Spens
|