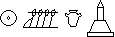
« Celui qui est agréable
au coeur de Rê »
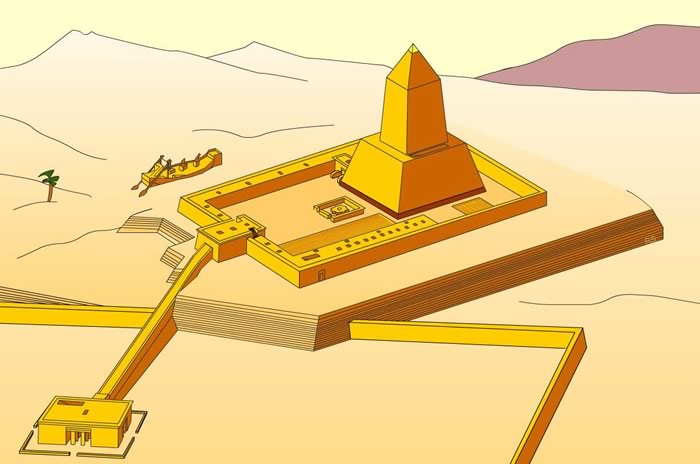
Reconstitution d'après Borchardt, corrigée |
Le temple solaire d'Abou
Gorab (anciennement fautivement appelé "pyramide
de Righa"), construit à la lisière
du désert par Nyouserrê, sixième
roi de la Ve dynastie, est structuré
autour d'un obélisque géant mesurant à
l'origine probablement près de 56 mètres
de haut, base comprise.
Les documents égyptiens
font mention de six temples solaires sous la cinquième
dynastie. Seuls deux sont surement identifiés,
et celui de Nyouserrê est le mieux conservé.
Il s'agit d'un type de monument
que l'état actuel de la documentation nous fait
apparaître comme tout à fait original.
Les vestiges de temples divins antérieurs au
Nouvel Empire sont extrêmement rares, et de surcroît
celui-ci, étant dédié à
Rê, suit un modèle particulier. Baigné
de lumière, il s'inspirait peut-être du
fameux sanctuaire d'Héliopolis, aujourd'hui disparu.
Découverte
Les savants de l'expédition
d'Egypte de 1798 repèrent des ruines à
quelques kilomètres au sud de Saqqarah. Le site
suscite quelque intérêt de la part de Perring,
puis de Lepsius (qui la nomme "pyramide 15"
sur son plan), Mariette et Villiers-Stuart.
Mais c'est la mission des
Musées Royaux de Berlin, comprenant notamment
Friedrich von Bissing, Ludwig Borchardt et Heinrich
Schäfer, qui entreprend les premières fouilles
véritables du temple, en trois saisons de 1898
à 1901.
Borchardt, architecte de
formation, reconstitue d’une manière vivante
et précise l’apparence initiale du monument.
Structure
Le temple est situé
sur une éminence rocheuse renforcée au
nord et à l'est par des terrasses en briques.
On y accédait par un porche monumental en aval.
Une longue chaussée montante d'une centaine de
mètres en partait. Couverte, elle était
sans doute très sombre. Le contraste était
donc d'autant plus saisissant lorqu'on arrivait dans
la cour du temple, inondée de lumière,
où s'élevait l'obélisque géant
(benben), masse de calcaire étincelante posée
sur une couche de granit rouge.
La base du monument était
creusée d'un couloir menant au sommet du socle,
d'où l'on devait jouir d'un point de vue exceptionnel.
Une porte de service donnait
sur le nord, accédant aux magasins. L'autel,
devant l'obélisque, était formé
de quatre signe hetep entourant un soleil,
formant le rébus "offrande à Rê"
vers les points cardinaux.
Deux espaces contenant rigoles
et bassins, parfois improprement appelés "abattoirs"
(aucun outil de boucherie n'a été retrouvé),
servaient sans doute à des rituels de libations.
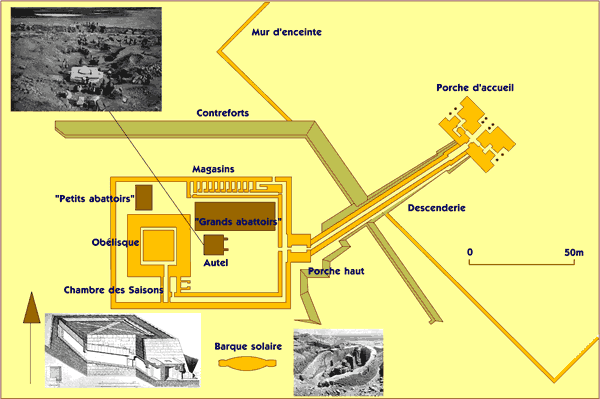
Au sud du temple, une barque
solaire en brique, singulièrement unique, rappellait
la pérégrination de l'astre.
Reliefs
De nombreux reliefs sont
mis au jour par l'expédition allemande. Une pièce,
la chambre de l'univers (Weltkammer) était décorée
des scènes des trois saisons. Les scènes
de fête-sed sont particulièrement riches
et originales, et leur niveau de détail ne peut
se comparer qu'avec celles, bien plus tardives, d'Amenhotep
III et d'Osorkon II.
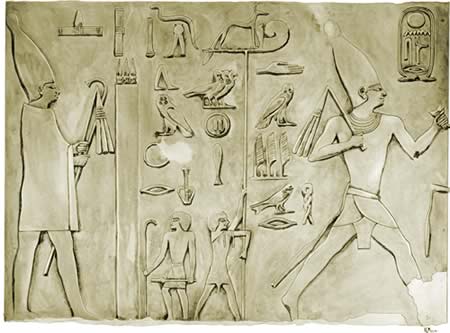
Postérité
Bien que le monuments ait
bénéficié de restaurations à
l'époque de Ramsès
II, on ne connaît pas de temple postérieur
s'en inspirant. Seuls les temples solaires d'Akhénaton
possèdent quelques caractéristiques similaires.
| Bibliographie
|
| Lexicon
der Ägyptologie.
Friedrich von Bissing (éd.), Das
Re-Heiligtum des Königs Ne-woser-Re (Rahutes)
I, II & III, Berlin 1905, 1923 & 1928.
Jacques Vandier, Manuel d'archéologie
égyptienne, Tome II (2), Les grandes
époques - L'architecture religieuse et
civile, Paris 1955, p. 582-594.
|
15/09/02
-
13/10/02
Renaud de Spens.